Note n°002 – La pensée complexe

Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments !
- Notes et bibliographie
- septembre 4, 2024
- No Comments
- Stéphane Durand
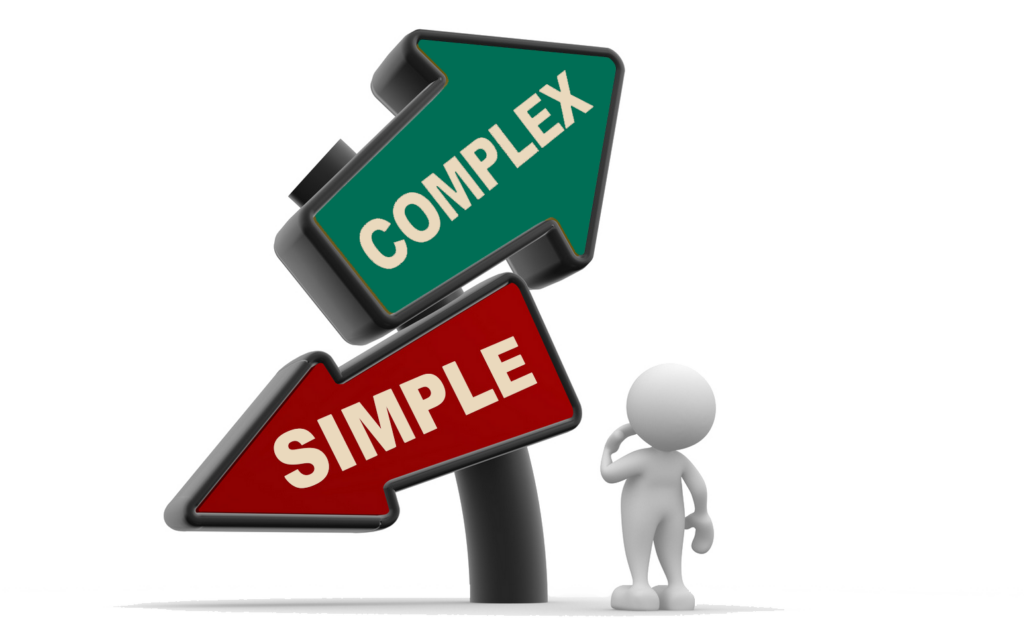
La pensée complexe, illustrée en particulier par les travaux d’Edgar Morin et de Jean-Louis Le Moigne en France ainsi que l’approche systémique qui lui est connexe et qui s’est particulièrement développée avec les travaux de l’École Palo Alto (Gregory Bateson, Paul Watzlawick notamment), nous enseigne que pour opérer des changements significatifs dans un système, qu’il soit naturel ou socioéconomique (sociétés humaines), il est nécessaire d’agir dans un ou plusieurs de ses sous-systèmes en intervenant principalement à leur périphérie, dans les marges.
Par exemple, si le système considéré dans le cas de l’aventure vécue par Olivier Erard est le Haut-Doubs et que l’objet d’étude est l’économie des loisirs et du tourisme, le travail se fait au sein de sous-systèmes de différentes natures. Déjà dans le sous-système « station de Metabief » et ses propres sous-systèmes (dont le domaine skiable et le groupe des métiers) puis dans d’autres sous-systèmes tels que la « communauté des acteurs du nordique »
Cela implique d’opérer des changements dans le cadre de travail.
Ce cadre construit par une autorité supérieure (contrainte) est constitué des finalités poursuivies (ce pour quoi le système existe), des ressources mises à disposition (notamment les compétences des acteurs) et des règles. Dans les « grands » systèmes, il est difficile de changer les règles en raison de l’inertie induite par la taille du système. Dans les « petits » systèmes, si la contrainte imposée par le haut entrave la capacité d’agir, cette dernière est facilitée par l’agilité dont disposent ces sous-systèmes.
Pour le passeur, un enjeu majeur est d’identifier les sous-systèmes dans lesquels des actions efficaces sont réalisables et potentiellement efficaces en raison de capacités d’action immédiates rendues possibles par une taille modérée du périmètre dans lequel il travaille. Il cherche aussi à dégager des marges de manœuvre dans le changement du cadre de travail et en particulier des règles qui le régissent. Agir à la périphérie, dans le cadre de la démarche menée dans le Haut-Doubs, cela s’est matérialisé de multiple manière.
Par exemple, en construisant et entretenant des alliances avec des acteurs du Département ou de l’Etat, en Suisse voisine, dans le cadre de projets européens ou plus spécifiquement, en construisant des ponts entre le référentiel structurant pour le territoire (SCOT, PCAET…) et la démarche ou en orientant l’allocation de ressources financières vers des sujets à fort effet de levier systémique.
Les expériences réussies dans un sous-système donnent lieu à l’ancrage de nouveaux repères et pratiques qui interagissent avec leur environnement dans une dynamique d’influence mutuelle et donc d’essaimage. Le sous-système développe en effet une nouvelle compétence dont les ingrédients deviennent progressivement attractifs et désirables pour l’externe.