Encart « Sur le chemin du passeur » – « Danser avec le système, pas à pas ! »
« A chaque jour suffit sa peine »

Retrouvez ici les encarts « Sur le chemin du passeur » présents dans l’ouvrage.
Nous vous invitons aussi, à consulter les notes bibliographiques situées sous le texte.
- A la une, Encarts "Sur le chemin du passeur"
- octobre 21, 2024
- No Comments
- Olivier Erard
Le mouvement provoqué par le passeur dans le système va inévitablement le déstabiliser.
Pour ne pas tomber, il doit adapter son rythme de progression et veiller à ce qu’à chaque étape, il soit bien en appui. La démarche du passeur est une démarche « pas à pas (note n°035) », où chaque appui compte.
L’appui « arrière » est fondamental : pour marcher, on s’appuie sur sa jambe arrière et si l’on veut marcher pendant longtemps, on pose le pied devant soi sans forcer l’ouverture de ses jambes.
La cadence des pas dépend du relief et de la qualité du chemin.
Le passeur est un marcheur qui adapte son rythme au contexte tout en tenant compte de sa physiologie. Sinon, il épuise son énergie. Donella Meadows (note n°036), dans son article Dancing with systems propose de bien sentir le rythme du système et conseille de ne pas plaquer son propre rythme ni ses propres projections et idéaux au système.
Pour ces raisons, mais aussi pour être clair à chaque pas, la motivation du passeur est à questionner ; pourquoi avance-t-il ?
Dans le grand bousculement que fait vivre la transformation, et parce que le doute est un compagnon indispensable, mais parfois très déstabilisant, la croyance dans des potentiels de transformation est fondamentale.
Mais quelle est la propre espérance du passeur ? Quelle cause sertil en réalité ?
S’il sert sa propre cause pour flatter son égo ou acquérir du pouvoir, le système va rapidement l’éjecter (note n°037) et son parcours s’arrêtera très vite.
Le passeur a l’intuition du bien commun, de la voie juste qu’il faut emprunter pour être en symbiose avec la nature (le fameux Tao) ; le passeur ne sait pas le « comment », mais pressent le « pour quoi ».
Peut-on parler d’espoir ou d’espérance ? Où puis-je trouver l’énergie nécessaire pour continuer de cheminer ?
Personnellement, j’ai des croyances qui me portent : je crois en l’humain malgré tout, en sa capacité à inventer des techniques régénératrices et réparatrices des dérives. Je crois que la nature est d’une grande puissance et d’une force telle que l’humain peut y puiser toute l’énergie dont il a besoin pour connaître la joie d’être vivant.
Le passeur peut discerner un autre repère que son intuition du bien commun, c’est de connaître SA compétence.
Pour le taoïste Tchouang-tseu, nous possédons tous une compétence à mettre au service du cosmos ; pour les taoïstes, l’humain est un maillon entre la Terre et le Ciel, au travers duquel l’énergie se déploie.
Lao-tseu raconte l’histoire d’un boucher qui pendant toute sa vie n’a utilisé qu’un seul couteau parce que ses gestes étaient d’une justesse parfaite.
Le passeur agit donc selon une intuition du bien commun en mobilisant une compétence permettant de diffuser le mouvement, une sorte de tension permanente qui évite au système de s’arrêter.
Ce mouvement peut être rapide, mais jamais précipité (note n°038).
À chaque pas, même rapide, le passeur vérifie l’ancrage, l’enracinement d’un appui permettant le prochain pas. Et ainsi de suite, selon le rythme que le système adoptera. Le passeur n’impose rien, il insuffle.
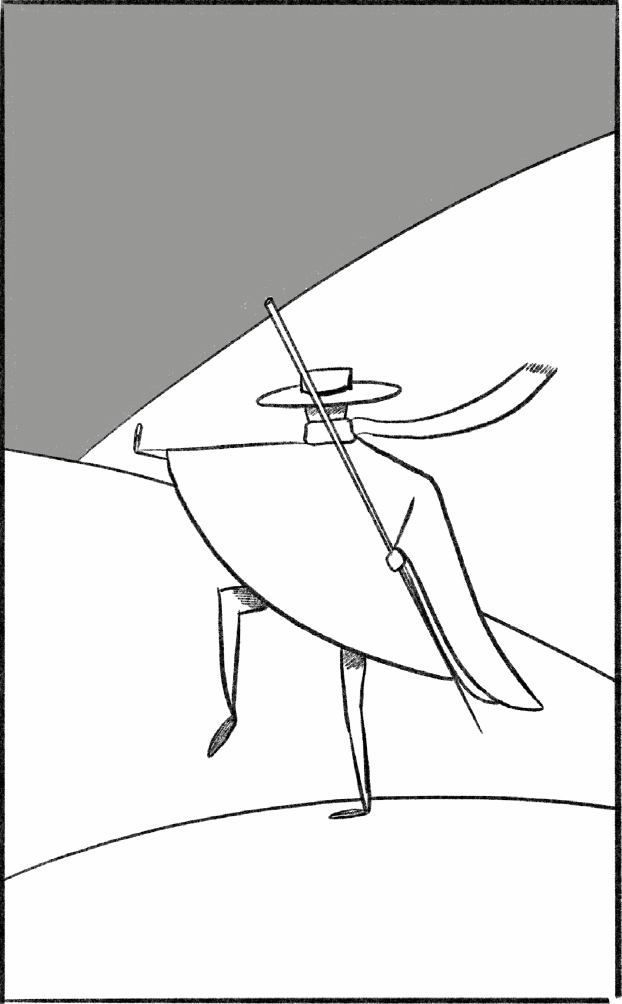
Texte d’Olivier Erard avec la contribution de Stéphane Durand, extrait de l’ouvrage « Le passeur » aux éditions Inverse///
Notes attachées au texte. Rédigées par Stéphane Durand.
Note n°035 – Démarche itérative
Note n°035 – Démarche itérative Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 24, 2024 No Comments Stéphane Durand Le principe directeur des méthodes dites agiles qui visent à faire avancer des sujets caractérisés par une bonne dose d’incertitude est celui des démarches itératives dans des cycles courts. Ce principe s’oppose à la planification qui s’inscrit dans une vision linéaire du temps tel que le « cycle en V ». Dans une telle démarche de planification, tout retour arrière est considéré comme un échec : une fois le diagnostic posé et la phase de conception réalisée, les démarches de planification linéaires invitent à réaliser la solution puis à l’utiliser. Les améliorations se font à la marge. Cette approche est très adaptée lorsque les hypothèses peuvent être recueillies de manière exhaustive et lorsqu’elles sont réputées stables dans le temps. Elles sont aussi nécessaires lorsque la mise en œuvre de la solution induit un risque sécuritaire conséquent hautement prévisible par exemple. Dans les démarches dites « agiles » dont « scrum » est l’une des plus connues, le retour d’expérience issu de l’utilisation par le client final d’un produit ou d’un service provenant d’une itération permet d’alimenter la réflexion sur les phases amont. Il va jusqu’à remettre en cause l’utilité et la faisabilité de la solution envisagée. Autrement dit, lorsqu’une idée germe, elle est concrétisée en partie, pour ce qu’elle a de plus intéressant. Sans s’encombrer d’une étude globale et des fonctions secondaires, le prototype partiel est testé et, si le retour est prometteur, alors est gardé ce qui apparaît vraiment intéressant pour laisser de côté ce qui l’est moins.
Note n°036 – Donella Meadows
Note n°036 – Donella Meadows Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 24, 2024 No Comments Stéphane Durand Donella Meadows est à l’origine du premier modèle par construction mathématique du système Terre, dont l’objectif était de réaliser une étude prospective relative au modèle de croissance économique occidental. Si c’est plutôt son mari, Denis Meadows qui fut le porte-drapeau de l’équipe de chercheurs du MIT dont les travaux ont été commandités par le Club de Rome, Donella Meadows a grandement contribué en créant ce modèle mathématique qui, s’il a été amélioré depuis, est toujours considéré comme une référence. Modèle dont les analyses produites, même avec un nombre de variables limitées et un algorithme adapté aux performances des ordinateurs des années 70, se révèlent, pourrait-on dire, hélas, très pertinentes. Son travail est visible dans le rapport The limits to growth, publié en 1972. Au-delà de sa contribution à ce travail collectif, Donella Meadows nous a laissé un ouvrage de référence traduit en français et paru en 2023 en partenariat éditorial avec l’ADEME. The limites to growth – Club de Rôme – 1972 « Pour une pensée systémique », Donella Meadows, éditions Rue de l’échiquier, 2023
Note n°037 – Le passeur sur la touche ?
Note n°037 – Le passeur sur la touche ? Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 24, 2024 No Comments Stéphane Durand Si le passeur sort de son rôle, le système ne le reconnaît plus. Le passeur est incarné par une personne, avec ses qualités et ses faiblesses. Son action est légitimée par une posture et une fonction qu’il assure dans le système. Si la personne qui endosse cette fonction adopte une posture de leader, alors, elle n’est plus un passeur. Si la personne contribue à ce que le rôle puisse exister dans un écosystème, sa légitimité est essentiellement contextuelle, comme celle du leader de la transformation. C’est un jeu d’équilibriste, tout comme la réussite de l’ascension d’une montagne par un chemin de crête sur un glacier, plus le soleil brille, plus les appuis sont fragiles. Il s’agit en fin de compte d’être suffisamment visible et bien placé pour être identifié, reconnu, légitimé, disposer de marges de manœuvre, d’un pouvoir de décision et d’action, tout en restant dans une posture d’accompagnant, de guide exigeant et bienveillant forçant le collectif au dépassement des limites des repères quotidiens pour l’amener à s’aventurer en terre inconnue.
Note n°038 – Prendre le temps d’aller vite
Note n°038 – Prendre le temps d’aller vite Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 24, 2024 No Comments Stéphane Durand Si le passeur est particulièrement à l’aise dans l’imprévu et sait s’adapter en situation, c’est qu’il dispose d’une préparation méthodologique et psychologique particulièrement robuste. Plutôt prospectiviste dans sa manière de voir le monde, il saura faire preuve d’initiative en situation et être réactif, souvent avec un geste approprié. Le passeur est généralement une personne curieuse, sensible aux signaux faibles, qui apprend très vite et à chaque instant. Il articule sa capacité à analyser une situation avec discernement grâce à l’entraînement dont il dispose, la connaissance de soi, l’écoute de ses émotions, sa vigilance aux biais cognitifs et son intuition, son sixième sens qu’il prend soin de développer et auquel il fait confiance, tout en étant conscient qu’il peut se tromper. Tout comme il sait qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il sait être patient lorsqu’il perçoit que la situation nécessite de se réguler d’elle-même. Le temps fait parfois bien son œuvre pourrait-on dire. Le passeur est en cela une forme de chef d’orchestre de l’ombre qui donne du rythme à la démarche tout en respectant le propre rythme du système. Il cherche à ce que la note juste tombe au moment opportun pour éviter le chaos destructeur d’une cacophonie des forces en présence dans le territoire.