Encart « Sur le chemin du passeur » – « Le passeur joue à un jeu d’échecs où tout le monde est gagnant »
« Le sens du collectif et de la diversité »

Retrouvez ici les encarts « Sur le chemin du passeur » présents dans l’ouvrage.
Nous vous invitons aussi, à consulter les notes bibliographiques situées sous le texte.
- A la une, Encarts "Sur le chemin du passeur"
- novembre 5, 2024
- No Comments
- Olivier Erard
La mise en mouvement d’un collectif vers un renouveau est un phénomène grisant et au début, le passeur peut se laisser bercer par l’illusion d’une cohésion autour d’un objectif commun (note n°049).
Après une séance d’intelligence collective qui s’est bien déroulée, le passeur pourrait avoir le sentiment d’avancer dans la bonne direction.
Cependant, il est indispensable de prendre en compte les réactions du système, sans pour autant prêter au système des intentions négatives.
Donella Meadows pense même que le système a les capacités de se transformer (note n°044). Elle parle d’une sagesse du système.
Cette sagesse ne s’exprime pas spontanément, elle se dégage une fois que les intérêts des uns et des autres se sont exprimés.
Le passeur ne doit pas être dupe sur le sens du collectif ; même si un intérêt collectif semble émerger, il n’est acquis que lorsque les actes suivent.
Un collectif n’adhère pas spontanément à un objectif même s’il est lucide sur la réalité des impératifs de changement (note n°045) : il construit cet objectif en frottant les pouvoirs des uns avec ceux des autres, ce qui fait émerger des tensions et des contraintes d’où jaillit une impulsion créatrice féconde.
Lorsqu’il est entré dans le système, le passeur a pris soin d’identifier le périmètre et les rôles de chacun (note n°046) ; il garde cela en observation, en permanence. Il sait dès lors d’où viennent les décisions et comment le système se met en mouvement, quels sont les acteurs moteurs, les freins, les facilitateurs. Sans cela, tous les gestes d’intelligence collective (note n°047) qu’il pourra accomplir risquent de ne pas être utiles, voire d’avoir des effets contre-productifs pour la transformation, ayant renforcé certains pouvoirs de conservation.
Le passeur doit accepter de ne pas plaire à tout le monde (note n°048) et peut avancer en créant des alliances, même de circonstance.
Il cherche à maintenir une ambiance bienveillante sans occulter les divergences, à influencer les comportements individuels et collectifs pour aider les acteurs à construire une nouvelle trajectoire. Le facteur temps est à gérer avec attention.
En effet, si les menaces de l’environnement remettent en question le modèle que défend le système, le groupe est d’abord motivé par l’idée de trouver rapidement une solution.
Souvent, le chef est le promoteur de cette solution. Le passeur veille à ce que cette solution soit une trajectoire compatible avec les enjeux environnementaux.
Le passeur a donc la capacité de garder à l’esprit une idée de trajectoire sans pour autant avoir le pouvoir ni la capacité de dessiner cette trajectoire pour le groupe.
Alors dans le mouvement qui agite le groupe, le passeur pourrait succomber à ses propres idées, ses propres désirs ou modélisations, ou adhérer trop rapidement à des solutions trop simplistes et trop peu systémiques.
Le passeur alterne alors entre influence et manipulation (note n°043). Ce n’est pas un facilitateur, ni un médiateur, ni un formateur ; un porteur de projet, c’est tout cela à la fois. Il a donc la lourde responsabilité de garder le sens du bien commun alors qu’il pourrait être amené inconsciemment à servir ses propres intérêts.
Le passeur joue à un jeu d’échecs où tout le monde est gagnant.
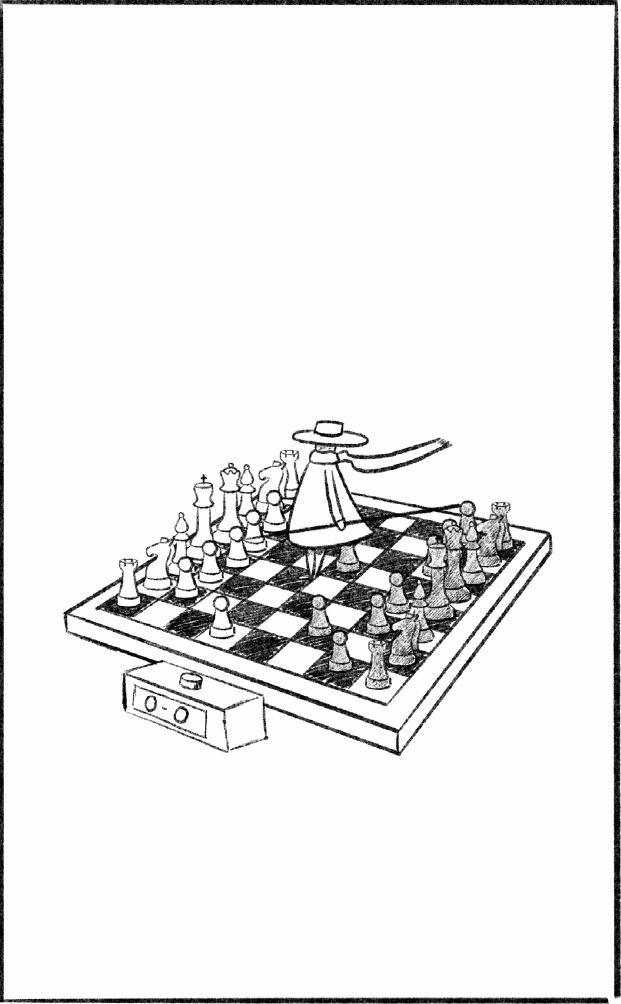
Texte d’Olivier Erard avec la contribution de Stéphane Durand, extrait de l’ouvrage « Le passeur » aux éditions Inverse///
Notes attachées au texte. Rédigées par Stéphane Durand.
Note n°043 – Le diable se cache dans les détails
Note n°043 – Le diable se cache dans les détails Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Au début d’une démarche de transformation, il y a nécessairement un besoin, conscient ou inconscient, de changer. Un ras-le-bol ou le sentiment qu’il existe des menaces nécessitant d’être prises au sérieux et qu’une évolution, une adaptation est nécessaire. Il est donc logique que les premières séquences de travail, celles dédiées au partage d’une forme de diagnostic et d’autant plus celles orientées vers la recherche de solutions, mobilisent les troupes, généralement dans une bonne ambiance. Une forme d’engagement naît de ces instants et la construction du collectif est motivée par un futur désirable commun. Tout le monde n’est pas d’accord avec l’intégralité du diagnostic posé ni même avec les solutions envisagées ou la manière de les déployer, cependant il existe généralement une forme de consensus autour de la nécessité de changer les choses et des grandes orientations esquissées. Le passage critique n’est pas la mise en place du camp de base. Les choses se compliquent lorsque le collectif passe de la théorie, d’un idéal projeté avec toutes ses nuances induites par les représentations individualisées du réel, à la pratique. La pratique qui met en exergue les renoncements et les efforts que chacun doit faire pour avancer. Des renoncements et des efforts bien souvent sous-évalués, par le collectif et par chaque membre qui le constitue. La robustesse de la démarche et son succès résident en la capacité du collectif à dépasser les immanquables situations de crise, le storming propre aux démarches de transformation (Voir note n° 32 « La transformation, fruit d’une crise »).
Note n°044 – Métamorphose
Note n°044 – Métamorphose Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Edgard Morin parle de métamorphose. Terme qui traduit une étape critique qui se termine soit par une transformation en profondeur du système, y compris au niveau de ses finalités, soit par un effondrement. Il n’existe pas à ce jour d’exemple de civilisations avancées ayant réussi leur métamorphose. L’ouvrage The Collapse of Complex Societies de l’anthropologue et historien Joseph Tainter témoigne de l’ampleur du défi qui s’offre à nous. Pourtant, un système complexe est doué de capacité d’organisation. Edgard Morin nomme cette capacité « autos ». C’est-à-dire qu’il est capable de mettre en œuvre des principes d’action qui adaptent les fonctionnements internes pour s’ajuster à de petits changements continus ou résister à des chocs. Cette capacité autos est une force pour nos sociétés qui, au travers de leur complexification, ont construit les fondations d’un château fort aux technologies avancées. Elle est aussi une faiblesse face au défi de résilience, c’est-à-dire la capacité à trouver de nouvelles solutions pour continuer à exister malgré des chocs d’une ampleur telle que des transformations profondes des fondations sont nécessaires. Le système possède donc en lui les capacités de transformation ; la réussite de celle-ci dépend de la volonté et des capacités des acteurs du système. Tribune « Eloge de la métamorphose » par Edgar Morin. Le monde 9 janvier 2010. Interview de Joseph Tainter « The Collapse of Complex Societies ». Chaine YouTube « Plan B ».
Note n°045 – Renvoi vers note n°043
Note n°045 – Renvoi vers note n°043 Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand
Note n°046 – Clarté des rôles et des périmètres
Note n°046 – Clarté des rôles et des périmètres Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand D’une manière générale, clarifier les rôles de chacun est un facteur de performance pour un collectif. Dans les situations et projets complexes, c’est un enjeu de premier plan. Clarifier les rôles ne signifie pas « figer » les rôles. Plus les situations sont complexes, plus le besoin de faire appel à certains rôles plus qu’à d’autres évolue avec le temps et les situations. Aussi, comme l’exprime Henry Mintzberg, il est nécessaire de garder « la marge de manoeuvre légitime », celle qui permet à une personne qui endosse un rôle particulier d’ajuster son périmètre de décision et d’action à la particularité d’une situation. Cependant, en environnement VUCA (voir note n° 12 « C’est flou ! »), il existe tellement de facteurs de stress, que clarifier les rôles des personnes au sein de l’équipe permet d’obtenir une forme d’assurance. Tout d’abord, cela permet de mettre en miroir les besoins et les rôles pour vérifier qu’ils sont bien exhaustifs, qu’il n’y a pas de « trous dans la raquette ». Ensuite, cela permet d’organiser les redondances. Éviter qu’une personne puisse empiéter sur le périmètre de l’autre et générer des tensions relationnelles non souhaitables tout en veillant à ce que l’absence d’une personne puisse être palliée par une fonction de suppléance pour les rôles endossés ordinairement par l’absent. Les équipes robustes clarifient les rôles et en régulent l’attribution de manière régulière. Un rôle disparaît, deux autres apparaissent. Une personne abandonne un rôle et une autre le reprend. Le système managérial proposé par la gouvernance cellulaire par exemple met la gestion des rôles au cœur de son approche. Les outils proposés par ce système de management, dont les ressources sont en accès libre et sur la base des travaux de Jean-Luc Christin, sont particulièrement efficaces pour définir et réguler les rôles au sein des équipes. Le référentiel de la Gouvernance Cellulaire
Note n°047 – Intelligence collective
Note n°047 – Intelligence collective Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Mobiliser l’intelligence collective est un levier de performance décisionnelle. Cependant, contrairement aux croyances répandues, il ne suffit pas de mettre les personnes autour d’une table pour développer l’intelligence d’un collectif : cela nécessite de mettre en œuvre une ingénierie dédiée et élaborée. Il y a plusieurs objectifs principaux qui peuvent être servis par les méthodes d’intelligence collective comme par exemple : Obtenir une représentation la plus fidèle possible de la réalité d’une situation complexe (auto-diagnostic partagé), Trouver des idées nouvelles avec des processus de créativité en intelligence collective ou réfléchir collectivement à une problématique complexe pour préparer les éléments d’une décision stratégique et en faciliter le déploiement. L’apprenance, l’engagement, la co-responsabilisation et la consolidation des fondations du collectif mobilisé sont des effets secondaires, hautement indispensables, qui émergent naturellement avec une méthodologie de travail adaptée. Un excellent ouvrage sur le sujet, avec une approche pragmatique et solidement éprouvée est celui écrit par Olivier Zara : l’excellence décisionnelle aux éditions Axiopol. Attention, les processus de concertation citoyenne tels que développés ordinairement, ne sont pas nécessairement des processus de management de l’intelligence collective. D’ailleurs, dans les faits, c’est plutôt un outil de justification de décisions déjà prises ce qui décrédibilise ces démarches. « L’excellente décisionnelle, la clé du succès dans l’excellence opérationnelle », Olivier Zara aux éditions Axiopole. Sur les processus de management de l’intelligence collective en lien avec les enjeux démocratiques, un autre ouvrage d’Olivier Zara « L’excellence démocratique – Réinventer la démocratie dans un monde complexe et incertain » fait référence, aux éditions Axiopole. Sur le sujet des transitions, un dernier ouvrage d’Olivier Zara « L’intelligence collective pour sauver la planète – Manifeste pour un futur désirable » vient de paraitre aux éditions Axiopole.
Note n°048 – Accepter de ne pas plaire à tout le monde
Note n°048 – Accepter de ne pas plaire à tout le monde Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand La mission de passeur nécessite, pour celui qui endosse ce rôle, de savoir « faire avec » la critique et ne recevoir que peu de signes de reconnaissance. Le passeur travaille pour le bien commun, cependant il sait que changer le système fera à court terme plus de mécontents que d’heureux. C’est un point important à considérer lorsque l’on se destine à accompagner dans l’ombre de grands projets complexes, afin d’être en mesure de prendre des décisions et de mener des actions, non pas pour plaire, mais pour servir des enjeux qui nous dépassent. Dans un projet de transformation, les repères bougent tout au long de la démarche. Ce qui était évident au début devient de moins en moins certain, pour devenir progressivement dans les esprits et au fil des mois et des années quelque chose de tellement absurde que cela devient mirage. Pour autant, rares sont les personnes qui seront en mesure de conscientiser et de verbaliser ce qui a changé dans leurs repères faits de croyances, de valeurs, d’expériences, de méthodes et de comportements. Finalement, le passeur tient sa reconnaissance principalement du niveau de conscience dont il dispose a posteriori pour apprécier le chemin parcouru.